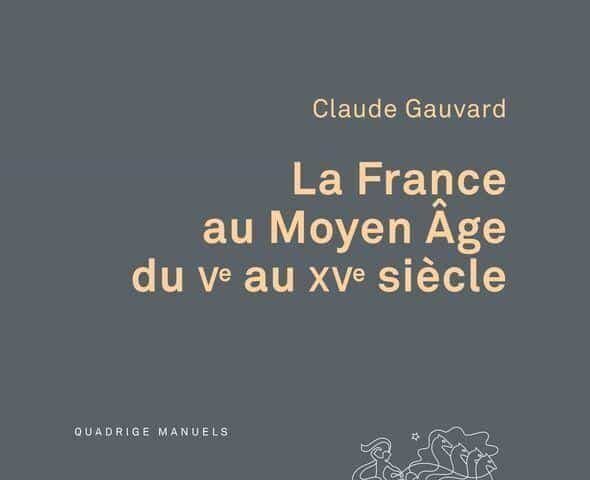1Suite à la dynastie mérovingienne, caractérisée de façon postérieure par Éginhard, auteur de la Vita Karoli comme des « rois fainéantes » en raison de la diminution du pouvoir royal face à la puissance majeure des aristocrates et du maire du palais, l’époque carolingienne témoigne d’un projet à rebâtir l’Empire romain, comprenant l’établissement et le développement des institutions politiques autour du roi ainsi que l’incorporation de divers peuples dans le territoire impérial (dilatatio regni). Cependant, ces tentatives novateurs connurent des difficultés dans leur mise-en-œuvre : le décalage entre la théorie politique par lequel Charlemagne concevait ses institutions et la pratique franque traditionnelle soutenue par les aristocrates, notamment en matière de l’administration de l’empire et de la succession, ainsi que la différence de coutume entre la Francie et les territoires conquis. Cela résulta en la fin de l’unicité de l’édifice politique carolingien et le début d’une tendance vers le partage de l’Empire dès la mort de Charlemagne. On remarque que cette recherche de pouvoir légitime et unique commence par l’onction de Pépin et ses deux fils Carloman et Charles en 754, suivi par les campagnes de conquête militaire de Charlemagne et culmine en son couronnement impérial le 25 décembre 800, ce qui instaure l’établissement des institutions jusqu’à sa mort en 814, d’où suivent des conflits autour de la succession pendant et après la règne de Louis le Pieux, notamment la bataille de Fontenoy entre Lothaire et l’alliance entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, avant d’un partage définitif de l’empire par le Traité de Verdun en août 843.
D’un côté, force est de constater que la notion d’« État », largement moderne, est étrangère à la période et ne connaît aucune traduction exacte dans la théorie politique de l’époque. Alors qu’il convient de la formuler afin de la problématiser, la référence de Max Weber à la « monopole de la force légitime dans un territoire défini » ne semble pas pertinente dans le contexte médiévale. Ainsi, reprenons la définition du médiéviste allemand Karl-Ferdinand Werner : « la capacité d’une entité politique à se servir d’agents exerçant une fonction publique correspondant à ce qu’on désigne aujourd’hui par « office » ou « charge politique » ». Par conséquent, le terme « Renaissance d’État » désigne l’élargissement du corps exerçant ces charges. D’autre côté, le concept d’« idée impériale » désigne ce que Charlemagne appelait renovatio imperii Romani, c’est-à-dire la refondation ou renouvellement de l’Empire romain en s’appropriant ses symboles et en incorporant divers peuples sous l’égide d’une seule entité politique.
Au bout de ce simple parcours on se rend compte que ces deux éléments poursuivis par Charlemagne s’accompagnaient l’un l’autre, mais aussi que les deux termes proposés par le sujet lui sont liés au sens où leur échec est déclenché par sa mort, dû au décalage entre ses idées et la pratique coutumière contemporaine. On peut ainsi se demander comment Charlemagne parvient à établir une unicité de pouvoir politique, légitimée par une nouvelle vision de l’héritage de l’Empire romain, une fondation qui toutefois ne réussit pas à se maintenir, en raison des normes politiques existantes.
D’abord, nous verrons les circonstances politiques de la recherche de légitimité et territoire qui précédait l’établissement des institutions carolingiennes, du sacre de Pépin en 751 jusqu’au couronnement de Charlemagne en 800 ; ensuite, nous analyserons la mise en place d’un corps politique centralisé sous la vision de la refondation de l’Empire romain et les défis rencontrés lors de sa mise en pratique, de son couronnement en 800 jusqu’à sa mort en 814 ; enfin, nous discuterons le conflit entre les idées romaines et la tradition franque qui déclenche le partage de l’Empire et signale la fin de la tendance d’unification initié par Charlemagne, de l’intronisation de Louis le Pieux jusqu’à la Traité de Verdun en 843.
Le sacre de Pépin le Bref par Boniface lors de l’assemblée générale des hommes libres en 751 et l’onction de Pépin et ses fils Carloman et Charles par Étienne III en 754 marquent respectivement les début de légitimité de Pépin face à son peuple et la sacralité de sa lignée, ce qui permettaient aux Carolingiens de se distinguer des roi mérovingiens, qui, à l’exception du baptême de Clovis, ne recevaient aucun geste symbolique affirmant leur rôle. Lemotif du sacre s’avère pragmatique ; selon les Annales royales des Francs, le Pape « ordonna par une prescription apostolique que Pépin fût fait roi afin que l’ordre ne fût pas troublé » puisqu’il répondit aux clercs envoyés par lui que « qu’il vaut mieux appeler roi celui qui a, plutôt que celui qui n’a pas le pouvoir ». Puis l’onction cimente également le statut de garant de sécurité du Pape aux rois carolingiens, puisque d’après le Liber pontificialis Pépin promet de restituer au Pape les territoires jadis cédés par l’empereur Constantin avant de fonder Constantinople.
Afin de obtenir le territoire requises pour ses ambitions territoriales, après la mort de son père Pépin et son frère Carloman, Charles conduisit une série de campagnes militaires : d’abord en 772 contre les Saxes, ensuite en 774 la conquête et annexion du royaume lombard et enfin en 778 une expédition échouée en Espagne contre les Vascons. En Saxe, ses méthodes brutales comprenaient le pillage des idoles païennes et d’Irmisul, l’arbre sacrée, ainsi que le baptême par le feu et le fer et l’interdiction de l’incinération de cadavres saxons, tout pour imposer la religion chrétienne. Malgré certains échecs comme en Espagne voire en Armorique, le royaume des Francs acquit une puissance considérable du fait de la dilatatio regnià la fin du VIIIe siècle, ce qui assurait des bonnes conditions pour Charlemagne, concentrant le pouvoir dans sa personne et établit d’ailleurs un système d’administration des marches, précurseur aux réformes administratives de sa règne. Les vassi dominici (vassaux du roi) participent à l’administration et aux conquêtes, ce qui contribueront à la formation d’un corps d’agents de la fonction publique après son couronnement.
Par ailleurs, les circonstances diplomatiques dans la Chrétienté occidentale contribuaient aux facteurs favorables au couronnement de Charlemagne. L’usurpation de la couronne de Constantin VI par sa mère Irène dans l’Empire byzantine, déjà affaibli par la Querelle des images, mit en cause la prétention des Byzantins de représenter tout le monde chrétien au moment de son couronnement, ce qui lui permettait d’acquérir des bases idéologiques pour son déclaration de la rétablissement de l’Empire romain d’Occident. Ainsi constata les Annales de Lorsch que le titre impérial « était vacant », et qu’il convenait au pape et à tous les présents au concile de « donner le nom d’empereur au roi des Francs Charles », établissant un lien idéologique direct entre la non-reconnaissance d’Irène et le besoin de couronner un empereur romain.
Nous avons vu que vers la fin du VIIIe siècle, les facteurs idéologiques et militaires requises pour l’arrivée de Charlemagne au pouvoir impériale furent saisies et des relations favorables avec l’Église furent maintenues, culminant au moment de son couronnement. Il convient donc d’illustrer son interprétation du modèle impérial, écartant à la fois de la conception de l’Église et la conception byzantine, ce qui influence les réformes administratives visant la création d’un État, ainsi que les défis face à des limites économiques et sociales, notamment dans la constitution d’un corps exerçant des charges politiques.
Le couronnement de Charlemagne eut lieu le 25 décembre 800, dans l’Église Saint-Pierre à Rome, utilisant le rite byzantin mais dont l’acclamation est mise après le couronnement et l’adoration, et lui accorda le titre de « Charles Auguste, empereur des Romains ». Alors que les vestiges de la domination impériale existait bien avant 800, telles que l’épithète Magnus accordé par le Pape en 775 ou les analogies architecturales frappantes entre la chapelle d’Aix-la-Chapelle, dont la construction commença en 790, et la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome, Charlemagne conçut une vision de l’empire centrée plutôt sur Aix-la-Chapelle que sur Rome, indépendante de la vision byzantine d’état théocratique aussi spirituel que temporel et de celle de l’Église qui voit l’empire comme investi en la papauté qui médiate la paix entre les rois et les peuples. À la suite du couronnement, des lettrés tels que Alcuin, Paul Diacre et Théodulfe se centrent autour de Charles et théorise sa théorie de domination impériale et élabore la fonction de son sacre : il est conçu comme un prince idéal de pouvoir laïc, comparé aux empereurs romains antiques, à Constantin ou à Théodose, mais qui exerce son pouvoir pour propager la foi et lutter contre les païens et hérétiques, à la fois dans et au-delà de son royaume. La différence narrative entre les Annales royales qui témoigne son mécontentement à la modification de la liturgie qui fait de son autorité un octroi du Pape et le Livre pontifical qui omit l’agenouillement du Pape devant Charles lors de la proskynèse semble démontrer le décalage entre les deux visions.
Suite logique de son positionnement comme empereur chrétien et pour la raison pratique du niveau d’alphabétisation très bas de l’époque, Charlemagne s’approprie du fonds intellectuel de l’Église en mobilisant les clercs lettrés pour constituer un système bureaucratique et l’étend en un corps administratif constitué par des ecclésiastiques et laïcs partout dans l’empire, afin d’effectuer sa gouvernance. Au niveau administratif, il conserva les services domestiques sauf la Mairie du Palais, décision qui paraît logique vu la puissance de cette dernière dans la diminution du pouvoir mérovingien, et créa une bureaucratie au-dessous de la structure ecclésiastique sous forme de chancellerie peuplée par des clercs lettrés dirigés par l’archi-chapelain, favorisant l’usage de la correspondance royale au lieu des messagers dans la vie administrative. Dans son Admonition générale, il essaye d’élargir ce corps en ordonnant l’établissement des écoles dans les cathédrales et monastères pour apprendre le latin aux enfants. L’introduction des minuscules carolingiens, devenues écriture standard pour la rédaction des documents, montre à tel point l’écrit contribue à l’efficacité croissante du système. Quant au pouvoir législatif, il institue le plaid général annuel, pendant lequel il proclame ses décisions les plus importantes, réunies en capitulaires auprès des vassaux et des notables laïcs et ecclésiastiques qui leur accordent leur promis d’obéissance. Au niveau local, il consolide le pouvoir en exigeant que tout homme âgé de plus de douze ans lui prête une serment de fidelité, et introduit des charges d’agent locaux nommés honores, dérivées de la potestas publica et dont existe deux niveaux, c’est-à-dire le comte et ses adjoints (l’échevin, le vicomte, les viguiers et les centeniers), qui président sur les tribunaux, l’imposition et la frappe de la monnaie, tandis que le comte touche un tiers de ses revenus. Pour empêcher toute instance de corruption, il évite le recrutement local, interdit la transmission de la charge de père en fils, et crée, en aval, les misi dominici, « envoyés du roi », comprenant un laïc et un évêque, qui surveillaient le comte et ses agents sous son charge, recevaient les doléances et les lui rapportaient.
Toutefois, les réformes faisaient face aux difficultés qui peuvent être attribués à la nature inédite de cet élargissement du pouvoir Étatique, alors que depuis la chute de l’Empire romain d’Occident le royaume franc n’avait pas connu que sa diminution. Le concept d’un res publica transcendante ou d’un sens civique qui motive le citoyen d’exercer étaient des notions cultivées incompatibles avec l’état de l’éducation de l’époque, ni furent les symboles des regalia comme la circulation monétaire assez répandus ; de ce fait le fonction publique carolingienne fut contraint à les substituer par des récompenses matérielles, telles que la terre ou les revenus, et des liens de fidélité personnelle. D’un côté, l’utilisation des récompenses matérielles semble transformer la charge en bien privé parmi les possessions du comte et ses adjoints ; d’autre côté, les liens de fidélité impliquaient des obligations réciproques et ne tenaient en sujétion que de manière indirecte les hommes à l’empereur via leur seigneur En outre, tandis que le sens civique faisait faute, on avait toujours raison à craindre que les comtes et les misi, issus de l’aristocratie, n’imposât leur solidarité de classe par-dessus des meilleurs intérêts de l’empire.
Ainsi nous avons vu que Charlemagne réussit à formuler une idéologie impériale d’un monarque de mission chrétienne mais laïque et arrive à bâtir une structure étatique plus solide que sous la dynastie mérovingienne, qui est toutefois empêché au terme d’efficacité locale faute de la compréhension des enjeux symboliques que celle-ci implique. Vers la fin de sa vie et après la mort de Charlemagne cette tendance de friction entre idées romaines et circonstances franques se développe en conflit entre l’unicité de l’idée impériale et la tradition franque de partage du royaume, ce qui engendra finalement la rupture de l’unité territoriale.
- Cette dissertation a été rédigée pour un devoir d’histoire médiévale en hypokhâgne. ↩︎